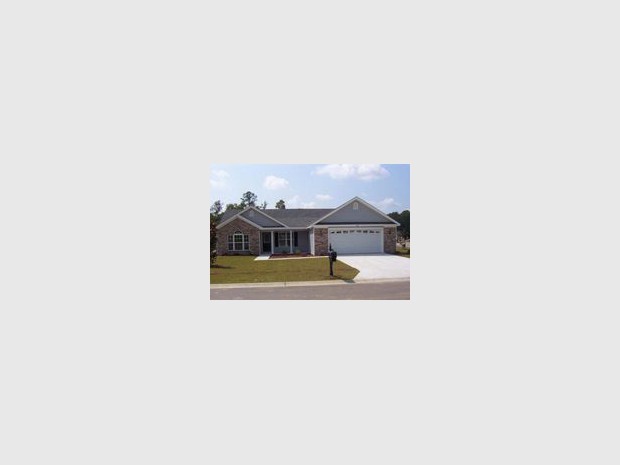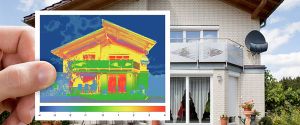Rues vides, détritus et poubelles jonchant la chaussée, vieux barbecues renversés, jardins transformés en terrains vagues, meubles gisant sur les pelouses, le quartier de Mount Pleasant, à l'est de Cleveland (Ohio, nord des Etats-Unis), donne l'image d'une ville dévastée.
Devant ces maisons désertées sont plantées des pancartes «A vendre». Les habitants sont partis, souvent expulsés parce qu'incapables d'assurer le remboursement de leur crédit immobilier. Là, c'est une bannière étoilée qui flotte. Les fenêtres et les portes des maisons sont obstruées avec des plaques de contreplaqué pour dissuader les trafiquants de drogue d'en faire leur QG. Des voleurs y ont parfois arraché la plomberie, les portes, les fenêtres ou encore les parements en aluminium.
Le parking du poste de police est saturé. Les agents reviennent d'une ronde. Ils disent avoir installé des alarmes de sécurité dans certaines maisons saccagées par les squatters. Au numéro 9422 de Union Avenue, un texte écrit à la main et accroché contre une fenêtre prévient: «Please, used» (S'il vous plaît, habité). Après trois coups de sonnerie, Sarah Evans, 60 ans, ouvre la porte, le regard mi-interrogateur, mi-effrayé. Elle dit être l'une des dernières habitantes de la rue. Elle est sur le point de perdre cette maison de deux chambres dans laquelle elle vit depuis 30 ans, car elle ne peut plus s'acquitter de ses traites mensuelles.
«Je pensais avoir réalisé mon rêve américain»
De manière confuse, elle explique avoir voulu refinancer son emprunt en 2003. Sans réaliser que le document qu'elle a signé prévoyait une forte augmentation du taux de l'emprunt. En 2006, elle a arrêté de verser les mensualités. Elle présente des factures non payées de 24.000 dollars. L'organisme de prêt vient de lancer une procédure d'éviction. «Quand quelqu'un achète une maison, c'est pour y mourir», affirme-t-elle. «Je pensais avoir réalisé mon rêve américain ! mais il s'est transformé en cauchemar», murmure-t-elle en donnant congé. Deux maisons plus loin, des aboiements de chiens de garde, installés par les banques - nouvelles propriétaires - dans des cages pour tenir à distance les vagabonds, lui font écho.
Le phénomène des «voisins qui disparaissent la nuit»
L'immense parking du supermarché Eagle Kinsman Fresh Market est vide. Derrière sa caisse, Myra Bibldwit lève à peine la tête quand retentit le bip signalant l'entrée d'un client. «Ca fait cinq heures que j'ai pris mon service, et je n'ai encaissé que dix personnes. Avec vous, ça fera peut-être onze», sourit-elle. Voire douze avec l'entrée de Laura Johnston, la cinquantaine. Laura raconte que sa rue, la 76e, à dix minutes en voiture, était encore animée il y a deux ans, mais que désormais plus de la moitié des maisons y sont abandonnées. «Les gens ne pouvaient plus payer. Ce qui m'énerve, c'est que je n'ai pas pu dire au revoir à mon amie Helen, qui s'est enfuie dans la nuit pour éviter le regard des autres», peste-t-elle.
Les cas comme ceux d'Helen, il y en a eu beaucoup. On les appelle ici les «voisins qui disparaissent la nuit». Pour Jim Rokakis, le trésorier du comté, les banques, par leur avidité, sont largement responsables de ce désastre humain. «Tout ce dont vous aviez besoin, c'était d'une envie de devenir propriétaire, le rêve américain», explique-t-il. «L'agent immobilier s'asseyait autour de la table, demandait aux gens combien ils gagnaient. C'était tout. Ils ne vérifiaient même pas les déclarations des gens. Le pire c'est que beaucoup étaient au chômage», enchaîne-t-il. Mount Pleasant «réunissait les ingrédients d'un tsunami immobilier parfait : des gens pauvres et désireux d'accéder à la propriété», conclut-il désabusé.
Le parking du poste de police est saturé. Les agents reviennent d'une ronde. Ils disent avoir installé des alarmes de sécurité dans certaines maisons saccagées par les squatters. Au numéro 9422 de Union Avenue, un texte écrit à la main et accroché contre une fenêtre prévient: «Please, used» (S'il vous plaît, habité). Après trois coups de sonnerie, Sarah Evans, 60 ans, ouvre la porte, le regard mi-interrogateur, mi-effrayé. Elle dit être l'une des dernières habitantes de la rue. Elle est sur le point de perdre cette maison de deux chambres dans laquelle elle vit depuis 30 ans, car elle ne peut plus s'acquitter de ses traites mensuelles.
«Je pensais avoir réalisé mon rêve américain»
De manière confuse, elle explique avoir voulu refinancer son emprunt en 2003. Sans réaliser que le document qu'elle a signé prévoyait une forte augmentation du taux de l'emprunt. En 2006, elle a arrêté de verser les mensualités. Elle présente des factures non payées de 24.000 dollars. L'organisme de prêt vient de lancer une procédure d'éviction. «Quand quelqu'un achète une maison, c'est pour y mourir», affirme-t-elle. «Je pensais avoir réalisé mon rêve américain ! mais il s'est transformé en cauchemar», murmure-t-elle en donnant congé. Deux maisons plus loin, des aboiements de chiens de garde, installés par les banques - nouvelles propriétaires - dans des cages pour tenir à distance les vagabonds, lui font écho.
Le phénomène des «voisins qui disparaissent la nuit»
L'immense parking du supermarché Eagle Kinsman Fresh Market est vide. Derrière sa caisse, Myra Bibldwit lève à peine la tête quand retentit le bip signalant l'entrée d'un client. «Ca fait cinq heures que j'ai pris mon service, et je n'ai encaissé que dix personnes. Avec vous, ça fera peut-être onze», sourit-elle. Voire douze avec l'entrée de Laura Johnston, la cinquantaine. Laura raconte que sa rue, la 76e, à dix minutes en voiture, était encore animée il y a deux ans, mais que désormais plus de la moitié des maisons y sont abandonnées. «Les gens ne pouvaient plus payer. Ce qui m'énerve, c'est que je n'ai pas pu dire au revoir à mon amie Helen, qui s'est enfuie dans la nuit pour éviter le regard des autres», peste-t-elle.
Les cas comme ceux d'Helen, il y en a eu beaucoup. On les appelle ici les «voisins qui disparaissent la nuit». Pour Jim Rokakis, le trésorier du comté, les banques, par leur avidité, sont largement responsables de ce désastre humain. «Tout ce dont vous aviez besoin, c'était d'une envie de devenir propriétaire, le rêve américain», explique-t-il. «L'agent immobilier s'asseyait autour de la table, demandait aux gens combien ils gagnaient. C'était tout. Ils ne vérifiaient même pas les déclarations des gens. Le pire c'est que beaucoup étaient au chômage», enchaîne-t-il. Mount Pleasant «réunissait les ingrédients d'un tsunami immobilier parfait : des gens pauvres et désireux d'accéder à la propriété», conclut-il désabusé.